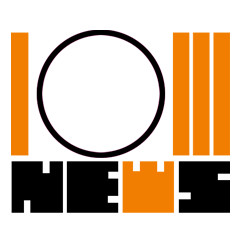"Le pays que je redécouvre est détruit, épuisé" : dans la Syrie d’al-Charaa, l’ex-patron de l’Ofpra témoigne
Ce jeudi 24 avril, tandis que la nuit tombe sur Damas, l’animateur de la première réunion depuis vingt-cinq ans du Forum démocratique syrien, une instance politique réprimée sous Bachar el-Assad, peine à organiser les prises de parole. "Nous sommes là depuis deux heures et il reste plus de 30 intervenants." C’est le premier effet de la chute de Bachar, le 8 décembre dernier : la libération de la parole après des décennies d’une impitoyable chape de plomb. Ils sont quelque 500 hommes et femmes – cheveux libres, cachés par un foulard et en burka pour l’une d’elles, à l’image des rues de Damas. La foule déborde du vaste salon et du jardin attenant dans la maison de Riad Seif, figure historique de l’opposition. De jeunes activistes côtoient des intellectuels et des militants historiques. Comme Nahed Badart, emprisonnée à plusieurs reprises puis exilée en France, qui revient en Syrie pour la première fois.
Il y a là des centaines d’années cumulées d’emprisonnements et de tortures. Fouad Naal, embastillé pendant douze ans à la terrible prison de Saidnaya dont il anime un comité de survivants, est le plus applaudi. Il nous le confirme au sortir de cette réunion historique : "On parle, c’est nouveau pour la Syrie". Qui plus est en présence d’Hind Kabawat, ministre des Affaires sociales et du Travail, chrétienne, seule femme membre du gouvernement issu de la prise du pouvoir par le mouvement islamiste Hayat Tahrir al-Cham (HTC), qui se joint inopinément à la réunion. Outre son émotion à la perspective de représenter officiellement la Syrie aux obsèques du pape, elle nous confiera avoir voulu donner un signal : "J’ai besoin de la mobilisation de la société civile." Toutes et tous veulent exprimer leurs impatiences et leurs inquiétudes. Enfin débarrassée de l’une des dictatures les plus sanglantes de la planète, la Syrie est désormais dirigée par Ahmed al-Charaa, ancien membre d’Al-Qaeda et du groupe Etat islamique - avant de les combattre - et de fonder le Front al-Nosra en 2012, puis HTC.
Quelle confiance accorder au nouveau régime ?
La veille au soir, dans une autre banlieue de Damas, autour de l’une de ces tables que les Syriens qui le peuvent encore couvrent de délicieux mezzés, Ali et Andalous, ingénieurs retraités de l’administration, s’étonnaient d’oser débattre sans crainte de la délation. La discussion a roulé librement avec leur fils Mustapha, un entrepreneur temporairement revenu d’exil en Malaisie. Mais surtout avec deux jeunes inconnus, Rayan et Saba, interprète et étudiante en médecine qui m’accompagnent. La question vivement débattue est celle qui hante nombre de Syriens : quelle confiance accorder au nouveau régime ?
Dès la nuit du 7 au 8 décembre 2024, à l’annonce de la chute subite de Bachar el-Assad, "le plus beau moment de notre vie", comme le dit Rayan, le besoin de partir à Damas pour partager avec la population ce moment historique de libération, d’espoir et de craintes s’était imposé à moi. Un voyage syrien en forme de réplique du 7 septembre 2015. Alors que des centaines de milliers de Syriens affluaient en Allemagne, j’avais proposé au gouvernement français de me rendre à Munich au-devant de quelques-uns d’entre eux avec les équipes de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) que je dirigeais alors. Le drame de ce pays m’avait trop accompagné durant ces années 2012-2019 en France, en Turquie, au Liban, en Grèce et en Egypte pour ne pas ressentir l’impérieuse nécessité de ce voyage.
Pour Muhammad Karkoush, accueilli à Munich en 2015 et installé avec sa famille à Toulouse. Pour Riyad Turk, emprisonné durant des décennies par les Assad, à qui j’avais remis avec déférence son titre de réfugié à son domicile parisien. Il est décédé sans avoir retrouvé son pays libéré de ses geôliers. Pour "César", ce médecin légiste rencontré dans les mêmes conditions après qu’il a fui la Syrie avec des milliers de photos de corps mutilés dans les prisons syriennes pour alimenter la justice internationale. Et tant d’autres.
Dès mon arrivée le 22 avril, la sauvagerie sans limites du régime déchu a pris la forme de kilomètres de débris de bâtiments sous le soleil sec et poussiéreux de Jobar. A quelques kilomètres de la superbe vieille ville de Damas, décrépite mais intacte, tout s’est figé depuis la destruction méthodique de ce quartier en 2013. Puni comme cent autres dans le pays pour s’être opposés en 2011, dans l’élan des printemps arabes. Rasés à coups de barils remplis d’explosifs, de carburant et de ferrailles largués depuis des avions. La même désolation muette nous attend le lendemain à Yarmouk, l’immense quartier damascène des Palestiniens de Syrie, martyrisés pour avoir pris le parti des insurgés contre le régime. De là étaient parties ces familles que nous avions extraites en 2014 des prisons d’Alexandrie et du Caire au bout de leur fuite achevée par un naufrage au large de l’Egypte.
Dans la désolation de Jobar, Jibril vient vers nous en tirant une maigre charrette. Il est bouleversé de pouvoir enfin témoigner devant des étrangers des tortures endurées en 2013. Il fut alors contraint d’expliquer - contre l’évidence - à une délégation des Nations unies que ces petites mortes sur les photos n’étaient pas ses deux filles victimes d’armes chimiques, mais des poupées. A l’écouter dans ces ruines remonte la colère qui n’a jamais cessé de m’habiter depuis 2013 en raison de ce qui fut longtemps la faiblesse, voire la complaisance, de la "communauté internationale" qui a – malgré la ténacité française – laissé Assad franchir toutes les "lignes rouges" chimiques. Et Poutine reproduire en Syrie les méthodes de destruction massive expérimentées en Tchétchénie. Une attitude partagée par une bonne partie de la classe politique française à l’égard d’un tyran auto-érigé en "rempart" contre l’islamisme radical. Les déclarations gouvernementales françaises et européennes lors de la chute de Bachar el-Assad ont réactivé ce sentiment : l’urgence ne fut pas de saluer la fin de quatorze années d’immenses souffrances mais… de suspendre l’accès au droit d’asile pour les Syriens.
En m’y rendant, je n’oubliais pas que la Syrie fut aussi le pays de provenance d’attaques contre notre pays par les assassins du groupe Etat islamique. A commencer par celles qui ont frappé Paris en 2015. Cette menace n’avait jamais cessé de m’obséder alors que je dirigeais l’Ofpra. Elle impose encore une vigilance de tous les instants. Mais rien n’interdisait au gouvernement français et à ses homologues européens, sans préjuger d’un avenir qui reste incertain, de se réjouir tout simplement avec les Syriens de la fin d’un terrible cauchemar. C’est ce que j’ai tenu à faire à Damas en ce mois d’avril 2025.
"Montrer les dents" pour obtenir des actes
La Syrie que je redécouvre trente-cinq ans après un premier séjour éblouissant est détruite, épuisée. Des millions de personnes sont encore déplacées dans des camps en Turquie, au Liban et en Jordanie. La quasi-totalité des Syriens survivent en dessous du seuil de pauvreté. Même si nombre d’entre eux conservent cette ouverture et cette résistance qui forcent l’admiration, les destructions touchent aussi les esprits. Ouddi, un jeune activiste, nous l’affirme comme nombre d’autres participants au sortir de la réunion du Forum : il faut maintenant "montrer les dents" pour obtenir des actes de la part du gouvernement.
Comme le rappelle l’un des participants au dîner chez Andalous et Ali, "il y a du sang partout dans ce pays". La Syrie se caractérise par sa diversité religieuse : une majorité sunnite et 15 % d’Alaouites, 15 % de Kurdes, 10 % de chrétiens, 1 % de chiites ismaéliens, ainsi que des Druzes. Le 24 avril au soir, ils sont tous représentés dans les fumées de cigarettes, le parfum du narguilé à la pomme du café al-Rawda, lieu de bouillonnement intellectuel dans le centre de Damas. Mahmoud, Elyas, Georges, Fadi et Fares nous y ont rejoints avec Rayan et Saba. Ils sont trentenaires, ingénieurs, médecins, pharmaciens. Ils témoignent de l’inquiétude des minorités face à l’insécurité hors de la capitale.
Le pouvoir des Assad, alaouites, n’a jamais cessé d’instrumentaliser les divisions religieuses et la montée d’un islam radical pour justifier son existence et son extrême violence. Il a semé une haine qui a germé dès le mois de mars dernier sur la côte méditerranéenne où résident nombre d’Alaouites. Après l’attaque meurtrière d’un barrage par des membres de l’ancien régime, une folie dévastatrice s’y est abattue sur des centaines de familles massacrées, réveillant les pires craintes. D’autant que le nouveau régime a, au minimum, laissé faire sans réagir, y compris les appels au djihad lancés depuis son bastion d’Idlib.
Les jeunes gens présents ce soir-là avec nous au café al-Rawda sont préoccupés par le comportement d’une génération entière meurtrie par la guerre, désœuvrée dans un pays détruit. Ils évoquent les "post" haineux d’adolescents sur les réseaux sociaux, les réflexions sur la consommation d’alcool. L’attitude de ses amis sunnites à l’égard des minorités supposées complices de l’ancien régime inquiète Mahmoud. Elyas nous a rejoints malgré les craintes de sa compagne, lui-même dit sa peur lors des contrôles sur la route depuis la côte. La présence de djihadistes étrangers (tchétchènes, turkmènes, ouïgours, maghrébins) alliés du nouveau régime y suscite la frayeur. Pour ne pas passer pour Alaouite, mieux vaut laisser en évidence une croix autour du cou. Tous témoignent ce soir-là d’une insécurité physique et économique qui les incite à envisager, la mort dans l’âme, de devoir quitter leur pays, tant ils "ne savent plus comment faire pour que ça change".
Les intentions du président Ahmed al-Charaa suscitent des interrogations au vu de son passé djihadiste. Le dialogue est certes engagé avec les minorités, représentées au sein d’un nouveau gouvernement qui compte également des technocrates. Mais le président tient sans partage les ministères régaliens avec ses compagnons de la première heure. Beaucoup semblent disposés à "leur donner une chance", comme Mustapha l’entrepreneur ou les responsables du Forum démocratique. C’est aussi le cas de Mahmoud. Ce jeune étudiant en médecine a vécu toute la guerre dans la région d’Idlib, seule restée jusqu’au bout hors du contrôle du régime et tôt passée sous celui du nouveau président. Il évoque devant nous avec émotion les manifestations de 2011 dans son village de Kafranbel, les bombardements par le régime, la férule de l’Etat islamique. Et la prise de contrôle progressive de la région par Abou Mohammed al-Joulani, nom de guerre d’Ahmed al-Charaa, où il met en place un gouvernement doté d’un impôt pour le "zakat", l’aumône pour les pauvres, fait reconstruire des routes et facilite l’accès à l’électricité. Cette expérience locale reste la référence revendiquée du nouveau régime, plutôt de bon augure selon Mahmoud.
Beaucoup veulent compter sur le réalisme des nouvelles autorités pour abandonner, ou tout au moins modérer, un projet d’islamisation rigoriste de la Syrie qui se heurterait aux réalités d’un pays plus divers que ne l’est le seul Nord sunnite et conservateur. Mais le doute subsiste face à l’ampleur de la tâche. Dans les rues de Damas, les troupes du HTC désormais intégrées à une nouvelle armée sont disciplinées, mais peu nombreuses. Et quelles sont les marges de manœuvre face aux pays voisins ? S’il est un consensus entre les Syriens, c’est la conviction d’être le jouet, de longue date, d’influences étrangères déstabilisatrices : Iran et Russie hier, Turquie, Arabie saoudite et Israël aujourd’hui.
Une nécessaire "justice transitionnelle"
Le devenir du pays dépend aussi des sanctions imposées à l’économie. Elles contribuent à sa paralysie, aux trafics et à une corruption de longue date endémique. Pour Mustapha, désireux, comme chef d’entreprise, de participer à la reconstruction, la levée des sanctions par les Etats-Unis et l’Union européenne lui apparaît indispensable et urgente. Les interminables files d’attente devant les distributeurs de billets témoignent de la pénurie de liquidités. C’est aussi l’opinion d’Abdulhay Sayed, avocat syrien installé en Suisse, que nous rencontrons avec son associé Zaydon El Haj dans son étude de Damas qu’il a tenu à conserver contre vents et marées. Ses travaux sur la "justice transitionnelle" font référence.
Une exigence que partage le Forum démocratique, comme l’a rappelé sa présidente, Joussama Seif. Reconnaître les responsables et les victimes des crimes du précédent régime est décisif pour prévenir la généralisation des violences. Cela devra prévaloir pour toutes les factions, y compris celles au pouvoir. Les résultats de la commission constituée par le régime à la suite des massacres de la côte en mars feront office de test. En insistant sur la nécessité de mettre en place des dispositifs de "protection", Me Sayed situe l’enjeu : établir un ordre constitutionnel permettant de construire une démocratie que ce pays n’a jamais connue. Autant d’exigences auxquelles la récente "Déclaration constitutionnelle" adoptée par le nouveau régime dans une longue phase qui se veut de "transition" ne répond pas encore. A la veille de notre retour en France, les jeunes gens réunis au café al-Rawda résument le programme : "sécurité, travail, Constitution". Ils m’interrompent : "Mettez la Constitution en premier, c’est la base de tout."
*Directeur général de l’Ofpra de 2012 à 2018, Pascal Brice s’est retrouvé en première ligne face aux conséquences du drame syrien et de la répression sanglante à Damas en 2011-2012.